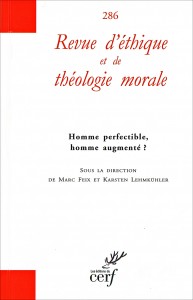Sophia, la seule "femme" citoyenne (!) à pouvoir sortir sans voile en Arabie Saoudite
Affichage des articles dont le libellé est humanisme. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est humanisme. Afficher tous les articles
jeudi 24 mai 2018
mardi 6 mars 2018
Transhumanisme vs Théôsis ?
« Homme perfectible, homme augmenté ? », un numéro hors-série de la « Revue d’éthique et de théologie morale
Recension par Jean-Claude Larchet
Marc Feix et Karsten Lehmkühler (éd.), Homme perfectible, homme augmenté ?, Actes du colloque de l’ATEM (Association des théologiens pour l’étude le la morale), Strasbourg le 29 août 2014, Revue d’éthique et de théologie morale, hors-série, n° 286, Éditions du Cerf, Paris, 2015, 226 p.
Au cours de ces dernières décennies se sont développées aux États-Unis, puis répandues dans le monde occidental, diverses théories qui se rattachent à ce que l’on appelle le courant transhumaniste, qui est puissamment soutenu par de grands groupes internationaux comme Google.
Ce courant vise à un dépassement des limites de l’homme actuel. Il comporte à un premier niveau la promotion de tous les moyens techniques permettant ce que l’on appelle en anglais un human enhancement, c’est-à-dire un perfectionnement et une « augmentation» de l’être humain. Comme le montre cette double traduction, ce dépassement est envisagé à des degrés divers qui peuvent aller d’un simple remède à des maladies ou des infirmités, jusqu’à une amélioration des performances physiques, psychiques et intellectuelles, réalisant un être humain ayant des capacités et des performances supérieures à celles de l’homme actuel. Cela débouche sur le concept plus large de transhumanisme, qui désigne un mouvement qui a l’ambition de créer un homme supérieur, ayant une nature différente de la nature présente, une nature qui accédera notamment à l’incorruptibilité et à l’immortalité, et à une toute-puissance sur elle-même et son environnement, une nature quasiment parfaite.
Cette conception qui remet en cause la conception de l’homme actuel, de ses limites, de son imperfection, et qui ambitionne de changer sa nature même pour lui conférer des qualités quasi-divines ne peut qu’interpeller les chrétiens. L’ATEM (Association des théologiens pour l’étude de la morale), qui réunit des universitaires catholiques et protestants spécialisés dans le domaine de l’éthique ou susceptibles d’apporter leurs compétences à la réflexion éthique, lui a consacré son dernier colloque annuel. Comme chaque année, un numéro hors-série de la Revue d’éthique et de théologie morale contient les Actes de ce colloque.
Une première partie regroupe les communications relatives à une « Approche philosophique et scientifique »:
— Bernard Baertschi, « “Human enhancement”: enjeux et questions principales »
— Jean-Louis Mandel, « Améliorer la condition humaine par la génétique? »
— Ghislain Waterlot, « Entre amélioration et aliénation: réflexions à partir de la “perfectibilité” chez Rousseau et chez Bergson »
— Pascale Lintz, « “Enhancement” et nanotechnologies »
— Otto Schäfer, « La notion d’ “homme végétal”, une piste pour renouveler le discours anthropologique chrétien? »
— Valentine Gourinat, « Le corps prothétique: un corps augmenté?
— Barbara Duarte, « Le piratage corporel ou “body hacking” au service de l’augmentation corporelle »
Une deuxième partie concerne l’« Approche biblique »:
— Christian Grappe, « La notion de perfection dans le Nouveau Testament et les réflexions contemporaines relatives à l’ “human enhancement” »
Une troisième partie contient les exposés se rapportant à l’« Approche d’éthique théologique et de spiritualité »:
— Karsten Lehmkühler, « La théologie face à l’amélioration de l’homme »
— Marie-Jo Thiel, « L’homme augmenté aux limites de la condition humaine »
— Alberto Bondolfi, « Comment argumenter à propos de l’amélioration de la condition biologique de la vie humaine? »
— Jean-Claude Larchet, « La déification (“théôsis”) comme accomplissement de l’homme »
— François Marxer, « Accomplissement, performance, dépassement: quelle excellence choisir? »
Ces communications ont, comme on l’aperçoit à leurs titres, des contenus très variés. Plusieurs d’entre elles ont souligné les limites de l’ambition de créer un homme parfait, tant du point de vue de sa réalisation technique que de son principe même, notant que le christianisme a fortement valorisé l’humilité et la faiblesse, dont le Christ lui-même, comme Dieu qui s’est fait homme, a montré l’exemple, et que le projet du christianisme consiste pour une part à assumer les limites de la nature dans l’état actuel qui est le sien, qui ne sont pas forcément négatives mais peuvent servir de support à une construction et une amélioration spirituelles de soi.
Ayant été invité à présenter le point de vue orthodoxe (qui s’est jusqu’à présent très peu exprimé dans ce débat, non seulement en France mais à l’étranger), j’ai pour ma part, dans l’introduction de mon exposé qui n’a pas été reproduite dans la version éditée, tout d’abord montré les limites internes du courant transhumaniste.
J’ai fait remarquer en premier lieu que celui-ci a deux fondements:
— Bien que l’on parle à son sujet de transhumanisme ou de posthumanisme, il s’enracine globalement dans l’humanisme né à la Renaissance et développé au XVIIIe siècle par les « Lumières », c’est-à-dire dans une conception qui considère l’homme comme existant d’une manière absolue, indépendamment de Dieu, pour lequel il ne peut y avoir aucun apport surnaturel, mais seulement un apport culturel, c’est-à-dire venant des productions sociales.
— Il est pour l’essentiel lié au progrès technologique, avec l’idée que c’est au moyen des nouvelles technologies surtout (en particulier robotiques, informatiques et génétiques) que l’homme pourra être amélioré, augmenté, transformé et dépassé ; dans ce sens il a une base matérialiste . Dans la mesure où les technologies se fondent sur les sciences, et où le transhumanisme pense que des solutions à presque tous – sinon à tous – les problèmes de l’homme pourront être apportées par les progrès technologiques fondés sur le progrès scientifique, il s’enracine aussi dans le scientisme, un courant philosophique né à la fin du XIXe siècle, selon lequel tout problème de l’existence humaine est susceptible de trouver, actuellement ou dans le futur, une solution dans la connaissance scientifique.Bien que le mouvement transhumaniste et en particulier les théories de l’enhancement se veuillent ultra-modernes (et même futuristes) on voit donc que leurs fondements reposent sur l’humanisme de la Renaissance, le rationalisme des Lumières, le scientisme du XIXe siècle et le technologisme né à la même époque.J’ai noté ensuite que, par rapport à ses fondements mêmes, le transhumanisme et ses corrélats présentent cependant un certain nombre de faiblesses :
1) L’humanisme en tant qu’idéal moral est mis à mal par le transhumanisme dans la mesure où en augmentant la part de technicité dans le fonctionnement physique et psychique de l’être humain, il réduit du même coup la part d’humanité, et pourrait, au terme de sa logique, déboucher sur « un monde sans humain » pour reprendre le titre d’une enquête récente de la chaine de télévision Arte.
2) La rationalité scientifique sur laquelle repose le technologisme du transhumanisme est mise à mal par la forte part d’illusion que comporte un monde transhumain, actuellement et sans doute à jamais bien plus imaginaire que réel. À cet égard, le transhumanisme, pour une grande part, relève plus de la science-fiction que de la science. Dans l’imaginaire qu’il développe se projette un certain nombre de fantasmes humains, comme un désir de perfection (physique, psychique et intellectuelle), de toute-puissance et d’immortalité acquises par des moyens humains.
3) Le transhumanisme se montre aveugle quant aux limites de la technologie face au vieillissement du corps humain dans sa totalité et quant à la mort qui constitue l’horizon inévitable de la vie humaine (on voit bien aujourd’hui comment l’augmentation de la durée moyenne de vie, dont la médecine se targue, est corrélée par toutes sortes de maladies dégénératives qui affectent le grand âge et ne trouvent leur solution que dans la mort).
4) Au lieu d’augmenter l’homme, comme il le prétend, le transhumanisme le diminue parce qu’il se centre essentiellement sur les performances ou les qualités du corps, et l’ampute donc pour une grande part de sa dimension psychique et pour la totalité de sa dimension spirituelle.
5) Dans la mesure où il vise à améliorer les performances psychiques et intellectuelles de l’homme, il les traite sur un plan essentiellement quantitatif, n’ayant de par sa nature technologique que peu de prise sur le qualitatif. La prétendue capacité de choix réalisée par des moyens informatiques, relève essentiellement de la classification et des probabilités, qui restent du domaine de la quantification. Les fonctions intellectuelles qu’il est susceptible de toucher restent de l’ordre du calcul et sont améliorées du point de vue de la rapidité, de la quantité d’information traitée, et du respect de règles logiques posées au départ. Elles manquent d’intelligence et de compréhension au sens d’appréhension du sens et de référence à des valeurs.
6) Lorsqu’il vise la qualité, comme c’est le cas de la génétique, le transhumanisme tombe dans des pratiques eugénistes contestables, et fait dépendre les choix de critères individuels (comme le désir ou la fantaisie des parents) ou sociaux (par exemple le besoin d’une société donnée d’avoir plus de filles ou plus de garçons, où, comme on l’a vu à l’époque du nazisme, le désir d’obtenir une race pure) qui sont non seulement discutables mais extérieurs à la personne concernée.
7) La plus grande faiblesse du transhumanisme et de l’enhancement est d’envisager une amélioration et une augmentation de l’être humain sans être capable de poser et de résoudre le problème de leur sens lorsqu’elles dépassent les limites d’une réparation ou d’un rétablissement d’ordre thérapeutique, ni le problème de leur valeur, ni même souvent, le simple problème de leur utilité.J’ai souligné enfin que le transhumanisme (en dehors de ce cas de visée thérapeutique, très particulier et non caractéristique) pose un problème par rapport à la foi chrétienne : ce mouvement, qui prend souvent la forme d’une idéologie, se positionne en effet sinon contre la religion, du moins comme un substitut (ou ersatz) de celle-ci.
C’est ce que fait apparaître le corps de mon exposé (édité dans ce volume) dont le but est de présenter le perfectionnement de l’homme et son dépassement tels que les conçoit le christianisme et plus spécialement tel que les ont théorisés, au cours du premier millénaire surtout, les Pères grecs dans leur élaboration de l’anthropologie chrétienne, et particulièrement dans leur doctrine de la déification de l’homme (theôsis).
mardi 26 janvier 2016
"Vous serez comme des dieux" (Genèse 3,5) : le projet transhumaniste, sa critique, et l'alternative orthodoxe : La déification (« théosis ») comme accomplissement de l’homme
“Le projet transhumaniste est vieux comme le monde humain : depuis toujours les hommes ont rêvé de géants, de sorciers, de héros invincibles ou immortels. Ce qui est nouveau c’est que l’accélération récente des capacités techniques apporte de l’eau au moulin transhumaniste dans la plupart des domaines, faisant crédibles des délires jusqu’ici à peine pensables. Et ce mouvement profite de deux phénomènes inédits : d’une part la mort de Dieu qui crée un vide à occuper par d’autres puissances issues de l’homme, d’autre part les catastrophes environnementales qui obligent à réagir au nom de la survie. Les réponses transhumanistes à ces défis dessinent, de façon encore très imprécise, un monde où l’homme (certains ? la plupart ? tous ?) bénéficierait de nouveaux pouvoirs grâce à des technologies en progrès exponentiel et illimité. L’humanité accéderait alors à la stature des héros rêvés depuis toujours, ce qui lui permettrait d’ échapper au sort funeste que ses propres actions ont préparé. Le transhumanisme se veut donc aussi une réponse à la crise écologique, mais c’est par la négation, voire l’exacerbation, des phénomènes qui ont créé la crise. Logiquement, il rencontre la sympathie de tous les acteurs irresponsables qui nient ces événements (négationnistes) ou qui en profitent (investisseurs en quête éperdue de croissance infinie). C’est dire que ce qui pourrait passer pour délire infantile venu du pays de Disney est à prendre au sérieux.”
Jacques Testart,
« Transhumanisme : pour quoi faire ? », article paru dans la revue Silence n°418, décembre 2013.
et une vision orthodoxe
La divinisation comme projet et modèle chrétien du perfectionnement et de l’augmentation de l’homme
Ayant été invité à présenter le point de vue orthodoxe (qui s’est jusqu’à présent très peu exprimé dans ce débat, non seulement en France mais à l’étranger), j’ai pour ma part, dans l’introduction de mon exposé qui n’a pas été reproduite dans la version éditée, tout d’abord montré les limites internes du courant transhumaniste.
J’ai fait remarquer en premier lieu que celui-ci a deux fondements:— Bien que l’on parle à son sujet de transhumanisme ou de posthumanisme, il s’enracine globalement dans l’humanisme né à la Renaissance et développé au XVIIIe siècle par les « Lumières », c’est-à-dire dans une conception qui considère l’homme comme existant d’une manière absolue, indépendamment de Dieu, pour lequel il ne peut y avoir aucun apport surnaturel, mais seulement un apport culturel, c’est-à-dire venant des productions sociales.— Il est pour l’essentiel lié au progrès technologique, avec l’idée que c’est au moyen des nouvelles technologies surtout (en particulier robotiques, informatiques et génétiques) que l’homme pourra être amélioré, augmenté, transformé et dépassé ; dans ce sens il a une base matérialiste . Dans la mesure où les technologies se fondent sur les sciences, et où le transhumanisme pense que des solutions à presque tous – sinon à tous – les problèmes de l’homme pourront être apportées par les progrès technologiques fondés sur le progrès scientifique, il s’enracine aussi dans le scientisme, un courant philosophique né à la fin du XIXe siècle, selon lequel tout problème de l’existence humaine est susceptible de trouver, actuellement ou dans le futur, une solution dans la connaissance scientifique.Bien que le mouvement transhumaniste et en particulier les théories de l’enhancement se veuillent ultra-modernes (et même futuristes) on voit donc que leurs fondements reposent sur l’humanisme de la Renaissance, le rationalisme des Lumières, le scientisme du XIXe siècle et le technologisme né à la même époque.J’ai noté ensuite que, par rapport à ses fondements mêmes, le transhumanisme et ses corrélats présentent cependant un certain nombre de faiblesses :1) L’humanisme en tant qu’idéal moral est mis a mal par le transhumanisme dans la mesure où en augmentant la part de technicité dans le fonctionnement physique et psychique de l’être humain, il réduit du même coup la part d’humanité, et pourrait, au terme de sa logique, déboucher sur « un monde sans humain » pour reprendre le titre d’une enquête récente de la chaine de télévision Arte.2) La rationalité scientifique sur laquelle repose le technologisme du transhumanisme est mise à mal par la forte part d’illusion que comporte un monde transhumain, actuellement et sans doute à jamais bien plus imaginaire que réel. À cet égard, le transhumanisme, pour une grande part, relève plus de la science-fiction que de la science. Dans l’imaginaire qu’il développe se projette un certain nombre de fantasmes humains, comme un désir de perfection (physique, psychique et intellectuelle), de toute-puissance et d’immortalité acquises par des moyens humains.3) Le transhumanisme se montre aveugle quant aux limites de la technologie face au vieillissement du corps humain dans sa totalité et quant à la mort qui constitue l’horizon inévitable de la vie humaine (on voit bien aujourd’hui comment l’augmentation de la durée moyenne de vie, dont la médecine se targue, est corrélée par toutes sortes de maladies dégénératives qui affectent le grand âge et ne trouvent leur solution que dans la mort).4) Au lieu d’augmenter l’homme, comme il le prétend, le transhumanisme le diminue parce qu’il se centre essentiellement sur les performances ou les qualités du corps, et l’ampute donc pour une grande part de sa dimension psychique et pour la totalité de sa dimension spirituelle.5) Dans la mesure où il vise à améliorer les performances psychiques et intellectuelles de l’homme, il les traite sur un plan essentiellement quantitatif, n’ayant de par sa nature technologique que peu de prise sur le qualitatif. La prétendue capacité de choix réalisée par des moyens informatiques, relève essentiellement de la classification et des probabilités, qui restent du domaine de la quantification. Les fonctions intellectuelles qu’il est susceptible de toucher restent de l’ordre du calcul et sont améliorées du point de vue de la rapidité, de la quantité d’information traitée, et du respect de règles logiques posées au départ. Elles manquent d’intelligence et de compréhension au sens d’appréhension du sens et de référence à des valeurs.6) Lorsqu’il vise la qualité, comme c’est le cas de la génétique, le transhumanisme tombe dans des pratiques eugénistes contestables, et fait dépendre les choix de critères individuels (comme le désir ou la fantaisie des parents) ou sociaux (par exemple le besoin d’une société donnée d’avoir plus de filles ou plus de garçons, où, comme on l’a vu à l’époque du nazisme, le désir d’obtenir une race pure) qui sont non seulement discutables mais extérieurs à la personne concernée.7) La plus grande faiblesse du transhumanisme et de l’enhancement est d’envisager une amélioration et une augmentation de l’être humain sans être capable de poser et de résoudre le problème de leur sens lorsqu’elles dépassent les limites d’une réparation ou d’un rétablissement d’ordre thérapeutique, ni le problème de leur valeur, ni même souvent, le simple problème de leur utilité.J’ai souligné enfin que le transhumanisme (en dehors de ce cas de visée thérapeutique, très particulier et non caractéristique) pose un problème par rapport à la foi chrétienne : ce mouvement, qui prend souvent la forme d’une idéologie, se positionne en effet sinon contre la religion, du moins comme un substitut (ou ersatz) de celle-ci.C’est ce que fait apparaître le corps de mon exposé (édité dans ce volume) dont le but est de présenter le perfectionnement de l’homme et son dépassement tels que les conçoit le christianisme et plus spécialement tel que les ont théorisés, au cours du premier millénaire surtout, les Pères grecs dans leur élaboration de l’anthropologie chrétienne, et particulièrement dans leur doctrine de la déification de l’homme (theôsis).
vendredi 13 novembre 2015
Le Christianisme occidental, religion humaniste
 |
| Otac Justin Popović (1894-1979) |
Parce qu'en Occident le christianisme et toutes ses infinies vérités divino-humaines ont été limités à l'homme, le christianisme occidental s'est transformé en humanisme. Cela pourrait paraître paradoxal, mais c'est vrai. C'est ce que montre indiscutablement la vérité historique. Le christianisme occidental, dans son essence, est l'humanisme le plus radical, parce qu'il a proclamé l'homme infaillible, et a transformé la religion divino-humaine en religion humaniste. La preuve en est ce fait que dans l'Eglise catholique-romaine, le Dieu-Homme a été repoussé au ciel et qu'à sa place a été installé un suppléant : le vicaire du Christ. Quelle tragique erreur ! nommer un remplaçant et un suppléant du Seigneur et Dieu omniprésent ! C'est pourtant un fait que cette erreur s'est incarnée dans le christianisme occidental.
Ainsi s'est effectuée d'une certaine manière, la dés-incarnation du Dieu-incarné, la dés-humanisation du Dieu-Homme. L'humanisme religieux occidental a proclamé que le Dieu-Homme qui est partout présent n'est pas présent à Rome, et lui a nommé un suppléant en la personne de l'homme infaillible. En tout cela, c'est comme si l'humanisme disait au Dieu-Homme: "Retire-toi de ce monde dans l'autre, éloigne-toi de nous, car nous avons ton remplaçant, qui te supplée infailliblement en tout".
Ce remplacement du Dieu-Homme par l'homme s'est manifesté en pratique par le remplacement évident des principes de la méthode chrétienne divino-humaine par la méthode humaine. Il en résulte la domination philosophique de l'aristotélisme dans la scolastique, la méthode casuistique, l'inquisition sur les mœurs, la diplomatie papiste dans les relations internationales, l'État pontifical, la rémission des péchés par les indulgences et par radio, et le jésuitisme sous ses diverses formes.
Tout cela conduit à la conclusion que le Christianisme humaniste représente en fait la protestation la plus décisive contre le Dieu-Homme et ses valeurs, et ses critères. Ici encore, apparaît la tendance favorite de l'homme européen, à résumer tout dans l'homme, comme valeur et mesure fondamentale de tout. Derrière se tient une idole: "Menschliches, Allzumenschliches" ("Humain, trop
humain").
En amoindrissant le christianisme, l'humanisme l'a indiscutablement simplifié. Mais en même temps il l'a détruit. Et puisque l'humanisme se présente avec le christianisme, aujourd'hui certains pensent en Europe à remplacer le christianisme humaniste par la vieille religion polythéiste. Les voix de quelques hommes dans le protestantisme: "Retour à Jésus !", représentent de faibles cris dans la nuit sans lune du christianisme humaniste qui a abandonné les valeurs divino-humaines et les mesures divin-humaines, et qui étouffe maintenant dans les impasses du désespoir, cependant que, du fond des siècles, font écho les sévères paroles du prophète affligé, Jérémie: "Maudit l'homme qui met son espoir dans l'homme" (Jér.17,5).
Dans une large perspective historique, le dogme occidental sur l'infaillibilité de l'homme n'est autre chose qu'un effort pour revivifier et éterniser l'humanisme mourant de l'homme européen. C'est la dernière métamorphose et glorification de l'humanisme, car après les Lumières du rationalisme du XVIIIème siècle, et le positivisme myope du XIXème, il ne restait plus à l'humanisme européen qu'à se désintégrer dans ses contradictions et son impasse. A cet instant tragique, l'humanisme religieux vient à son aide, et, par son dogme sur l'infaillibilité de l'homme, sauve l'humanisme
européen d'une mort évidente. Mais, même dogmatisé, l'humanisme chrétien occidental, n'a pu contenir en lui toutes les contradictions
mortelles de l'humanisme européen, qui tendent vers un désir unique: chasser le Dieu-Homme du ciel et de la terre, car pour l'humanisme, ce qui est principal et fondamental, c'est que l'homme devienne la valeur suprême et le critère ultime." St Justin de Tchélié
(in L'homme et le Dieu-homme" traduit du serbe par Jean-Louis Palierne- Edition de l'Âge d'homme -
jeudi 4 décembre 2014
DE QUELLE ”PAIX SUR TERRE” EST-IL QUESTION DANS L’ HYMNE ANGÉLIQUE DE BETHLÉEM?
Peu de passages de la Sainte Écriture ont fait l’objet d’une interprétation aussi erronée que le verset 14 de l'Évangile selon saint Luc. Il s’agit de l’hymne entonné par les anges lors de cette nuit divine de la Nativité du Verbe Divin, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette méprise de la part de nombreux orthodoxes n’est naturellement pas voulue ou faite à dessein (seuls les hérétiques déforment les textes volontairement), mais elle est due à 1’ignorance du sens intégral de la Sainte Écriture. En raison de cette ignorance, chaque année, le jour de Noël, nous entendons des prédications, ou nous lisons des écrits de nombreux dispensateurs de la parole évangélique de notre Église, tant prêtres que laïcs, qui se lamentent parce que les guerres n’ont pas encore pris fin, les armes n’ont pas été supprimées, et la paix de l’hymne évangélique ne règne pas encore sur terre. Même les encycliques ecclésiastiques officielles formulent de telles positions, ainsi que des supplications à Dieu afin qu’Il permette le règne de cette paix de l'hymne angélique, «qui, depuis deux mille ans, reste loin de la réalité, simple espoir, simple rêve, et une attente anxieuse ». Ces infortunés ignorent que la paix de l'hymne angélique est déjà devenue réalité et prédomine sur terre depuis l’Incarnation du Seigneur. Nous concevons de manière mauvaise et erronée cette paix, en croyant qu’il s’agit d’une paix extérieure, d’un état d’amitié entre les hommes, entre un individu et un autre, entre un peuple et un autre peuple, tout ceci étant accompagné de la cessation des guerres et des combats.
Une telle paix n’a jamais été annoncée dans l’Évangile : celle-ci est intérieure, elle est l’état de calme qui règne dans l’âme de l’homme croyant, de l’homme qui est en communion avec Dieu. Il s’agit de la paix entre 1’homme et Dieu, et non de l’homme avec un autre homme. C’est le renversement du «mur de séparation », qui séparait la terre et le ciel, l’homme et Dieu. C’est la fin de la révolte, celle de la création contre le Créateur. C’est cette paix qu’apporte au monde le Fils de Dieu. Depuis lors, chaque croyant en Jésus-Christ Incarné, Crucifié et Ressuscité, a Dieu pour ami et se trouve en communion filiale avec Lui. Il n’est plus rebelle, révolté, ennemi de Dieu, il a été «réconcilié» avec Lui par le Médiateur éternel, le Seigneur Jésus-Christ. L’état de révolte et d’inimitié envers Dieu appartient entièrement au passé et ne constitue pour le fidèle qu’une simple mais amère réminiscence. Depuis la venue du Seigneur et par la force de Son sacrifice sur la Croix, l’homme est entré dans une nouvelle période, un nouvel état, celui de la Grâce, de la Réconciliation, de la Filiation. Les promesses de paix du saint Évangile se rapportent à cette paix et non à la paix du monde extérieur : «Je vous laisse la paix, dit le Seigneur aux Apôtres, C’est ma paix que Je vous donne ». Et pour souligner que cette paix est une paix d’une autre sorte, Il ajoute : « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne» (Jn 14,27). En outre, dans un autre passage, parlant de la paix extérieure, Il dit qu’Il ne l’apporte pas. Au contraire, Il prévoit que la foi en Lui sera cause de discordes entre les hommes. Les incroyants persécuteront les fidèles de Jésus et, ainsi, les guerres non seulement ne diminueront pas, mais augmenteront, en ce sens qu’à celles qui existent, s’ajoutera celle qui se dirigera contre la nouvelle foi. «Ne pensez pas, dit-Il, que je sois venu apporter 1a paix sur 1a terre ; Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car Je suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère » (Mt 10,34-35).
Avant d’avoir été conduit volontairement sur le Golgotha, afin de boire le calice d’une mort terrible, Il accorda la paix intérieure aux Apôtres, une paix qui ne sera pas troublée par des myriades d’épreuves et d’afflictions extérieures. Malgré celles-ci, cette paix existe, car, précisément, elle est intérieure : «Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en Moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J’ai vaincu le monde » (Jn 16,33). Il accorda la paix aux Apôtres, tout en sachant quelles morts douloureuses les attendaient, tout en leur disant ouvertement qu’Il les envoyait «comme des brebis au milieu des loups» (Mt 10,16). Était-il donc possible qu’Il leur accordât la paix extérieure ? Sûrement pas!
Quant à saint Paul, il est le prédicateur et l’apôtre de cette paix intérieure, de cette paix envers Dieu: «Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ », écrit-il aux Romains (5,1). S’adressant cette fois aux Éphésiens, il dit que le Seigneur Jésus-Christ est «notre paix », Celui qui est venu proclamer 1a paix... «par Lui nous avons en effet... libre accès au Père » (Éph. 2,14-18).
En conclusion: la paix de l’hymne angélique est la paix de l’homme avec Dieu, il ne s’agit pas d’une paix extérieure. Cette paix a régné véritablement «sur terre», celle-ci a été réconciliée avec le ciel par l’humilité jusqu’à la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est inutile d’ajouter que l’homme qui est en paix avec Dieu, est en paix avec ceux de l’extérieur. Seul un tel homme peut dire: « Avec ceux qui haïssent la paix, j’étais pacifique » (Ps 119,16). Il aime et fait du bien même à ses ennemis. La paix intérieure est la condition préalable à la paix extérieure. Quant à la paix extérieure, elle n’est pas seulement inaccessible, mais inconcevable sans la paix intérieure. Telle est précisément la tragédie de notre époque : tandis qu’elle a déclaré la guerre à Dieu, elle recherche anxieusement la paix entre les hommes. Tandis qu’elle est totalement indifférente à la paix intérieure, elle recherche à cor et à cri la paix extérieure. Elle déraciné 1’arbre et attend les fruits; elle détruit la maison et recherche sa chaleur ; elle s’éloigne du soleil et veut la lumière.
 |
| "Acquiers un esprit de paix, et des milliers autour de toi seront sauvés." |
De tous temps, «l'objet du désir de tous les hommes» est « la paix » (Est 3,l2a). Cependant, aucune époque n’a autant que la nôtre eu soif de la paix. Réussirait-elle donc là où toutes les autres époques ont lamentablement échoué ? En d’autres termes, réussirait-elle à construire la paix sans Dieu? Mettrait-elle fin aux terribles armes d’aujourd’hui? Ferait-elle des guerres des souvenirs historiques lointains? A l’aide de quoi? De la science? De la technologie? De l'humanisme? De la profondeur des
siècles retentit l'avertissement clair, catégorique et saisissant, dont la vérité et la valeur sont, hélas, confirmées! Une amère expérience de presque trois millénaires qui se sont écoulés depuis: «Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits de la terre. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche du Seigneur a parlé.» (Is 1,l9-20). Que ce glaive soit un glaive ordinaire ou un autre, d’une nouvelle conception, comme, par exemple, le produit de l’énergie
nucléaire, n’a que peu d’importance en soi...
« Seigneur notre Dieu, donne-nous la paix, car Tu nous as rendu toutes choses. Seigneur notre Dieu, prends possession de nous...» (Is 26,l2-13).
P. Épiphane Théodoropoulos
Texte traduit par B. Le Caro
in Le Messager Orthodoxe n°103. L'original est paru dans le périodique grec Koinonia en 1984.)
jeudi 27 novembre 2014
«L'identité chrétienne de l'Europe» ? par l'Archimandrite George Kapsanis
Notre prise de conscience de nous-mêmes en tant que
chrétiens orthodoxes ne nous permet pas de négliger le fait que l'Orthodoxie et
le christianisme occidental ne peuvent pas partager une même «identité
chrétienne». Au contraire, cela nous oblige à insister sur le fait que
l'Orthodoxie est la foi chrétienne originelle que l'Europe a oubliée depuis longtemps, et qui, à un moment donné, devrait à nouveau servir de fondement à son
identité chrétienne.
L'Europe unie du XXIe siècle s'efforce
de trouver son identité. La question de «l'identité européenne» n'a pas cessé d'être un grave problème depuis qu'elle a été forgé seulement avec des facteurs
économiques et politiques. Cependant, à partir du moment où les facteurs
culturels et en particulier religieux devaient être pris en compte dans la
tentative pour la définir, il ya eu de graves débats, de profonds désaccords et d'âpres différends sur la question de savoir si la «Constitution européenne»
devrait faire référence à l'identité chrétienne de l'Europe.
Mais qu'est-ce que «l'identité chrétienne
de l'Europe» signifie pour nos peuples orthodoxes? En quoi est chrétienne est
«l'identité chrétienne de l'Europe»?
Tous ces individus bien intentionnés qui
s’efforcent de renforcer le concept de l'identité chrétienne de l'Europe
parlent généralement d'elle comme si c'était un fait historique ou un code de
principes et de valeurs chrétiens auxquels les peuples chrétiens de l'Europe
peuvent conjointement adhérer par le moyen de contacts œcuméniques et de
dialogue inter-chrétiens. Les chrétiens d'Europe veulent voir le concept
inscrit dans le cadre institutionnel de l'Europe parce qu'ils ont peur que
l'identité religieuse de leur continent puisse être affaibli et son caractère
chrétien altéré à la suite des changements de population (migrations etc.),
ou que les organisations chrétiennes inter-églises puissent être exclues des
centres européens de prise de décision. Suivant la même logique, même les
propositions des représentants orthodoxes officiels se concentrent sur le
renforcement d'une présence chrétienne institutionnelle en Europe.
L'Église orthodoxe
En vivant comme je le fais dans
l'environnement du mont Athos et le climat spirituel qu'il crée, je peux voir
que notre patrimoine orthodoxe ne doit pas être mesuré aux normes de ce
monde. Au cours des dernières années, j’ai été témoin de la piété et de la foi
profonde des pèlerins visitant l’Athos, dont beaucoup viennent, au prix de
grands efforts et dépenses, des pays des Balkans et de la Russie.
Dans l'esprit de tous ces pieux chrétiens
orthodoxes et de tous ceux qu'ils représentent de retour dans leurs pays
d'origine, l'Orthodoxie ne signifie généralement pas la même chose que pour ceux qui la voient ou la considèrent avec des critères idéologiques ou
sociologiques - ces gens qui confondent habituellement les croissants
orthodoxes d'ici dans l'Orient orthodoxe avec ceux qui sont dans le monde musulman,
ou considèrent l'Orthodoxie comme une force nationaliste parmi les peuples qui
l'embrassent. Peu importe dans quelle mesure, nous, orthodoxes, créons ces
impressions, suite à nos faiblesses personnelles ou à des erreurs collectives,
nous croyons profondément que l'Orthodoxie est quelque chose de beaucoup plus
substantiel, sublime et impérissable : c’est le don inestimable du Saint Dieu
trinitaire au monde, la « foi confiée une fois pour toutes aux saints» (Jude
3), que notre Église orthodoxe conserve dans sa plénitude, sans distorsions
hérétiques, et que nous avons conservée dans les moments difficiles afin de ne
pas perdre notre espérance en la vie éternelle.
Nous, peuples orthodoxes avons été jugés
dignes par Dieu dans sa miséricorde de porter le sceau du Saint Baptême
orthodoxe, de participer à la Sainte Eucharistie orthodoxe, de suivre
humblement les enseignements doctrinaux des sept conciles œcuméniques comme la
seule voie de salut, et de garder «l'unité de l'Esprit par le lien de la paix»
(Ephésiens 4: 3). Nous portons bien sûr l'héritage de la foi orthodoxe « dans
des vases d'argile »(II Corinthiens 4: 7), mais par la grâce de Dieu ce qui
représente la raison de « l'espérance qui est en nous» (I Pierre 3: 5) .
Notre Église orthodoxe n’est pas
seulement une arche de notre patrimoine historique national. C’est d'abord et
avant tout l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
Afin de ne pas perdre l'espoir de leur
salut éternel dans le Christ les peuples orthodoxes des Balkans ont conservé
leur foi orthodoxe à travers les sacrifices de milliers de néo-martyrs, qui ont
résisté autant à la conversion à l'islam qu'à la conversion à l’Église uniate Pour
cette raison, la résurgence récente des uniates qui s’est produite depuis
l'effondrement des régimes athées, ainsi que le prosélytisme actif des
confessions néo-protestantes parmi les populations orthodoxes, représentent de
sérieux défis pour l'Église orthodoxe. Et en tant que tels, ils doivent être affrontés,
car une fois de plus, ils mettent en péril le salut des âmes simples « pour
qui le Christ est mort» (Romains 14: 15).
Dans les sociétés traditionnellement
catholiques et protestantes de l'Ouest, en outre, lorsque les paroisses
orthodoxes existent et fonctionnent, la présence orthodoxe doit être un humble
témoin de l’authentique christianisme, dont ces sociétés ont été privées depuis
des siècles en raison des déviations de la foi apostolique des papes et des protestants. Chaque fois que la recherche
nostalgique de la forme pure et inaltérée de la foi chrétienne culmine dans le
retour des chrétiens hétérodoxes au sein de l'Église orthodoxe, Une, Sainte, Catholique et Apostolique, le
caractère missionnaire de l'Église s’exprime. En revenant à l'Église orthodoxe,
les chrétiens d'autres confessions n’abandonnent pas une église afin d'en embrasser
une autre, comme beaucoup le croient à tort. En réalité, ils laissent une forme
anthropocentrique de l'Église pour redécouvrir la seule et unique Église du
Christ, ils deviennent membres du Corps du Christ et sont remis sur la route de
la déification.
Le Saint Monastère de St Grégoire sur le Mont Athos
Théologie et «théologie»…
Malheureusement, l'œcuménisme, cette philosophie syncrétiste qui s’est exprimée par les organes institutionnels du
Mouvement dit œcuménique et des
représentants de l'œcuménisme papocentrique, se dirige dans la direction
opposée. Comme ils ignorent l'ecclésiologie orthodoxe et suivent la « Théorie
des branches » protestante ou la récente théorie Romano-centrée des «Églises
sœurs », ils croient que la vérité de la foi apostolique, ou une partie de celle-ci,
est conservée dans toutes les églises et confessions chrétiennes. C’est
pourquoi ils dirigent leurs efforts vers la réalisation de l'unité visible
entre les chrétiens, sans plus considérer l'unité plus profonde de la foi.
En ce sens, la «théologie» œcuméniste considère
comme égaux le Baptême orthodoxe (avec sa triple immersion) et le rite
catholique de l'aspersion ; elle considère également l’hérésie du Filioque
comme doctrinalement égale à l'enseignement orthodoxe sur la procession du
Saint-Esprit selon le Père seul, et interprète la primauté de service du pape de Rome comme une primauté d'autorité, de même elle considère comme simple théologoumène (opinion théologique)
l'enseignement orthodoxe sur la distinction entre l'essence et les énergies de
Dieu et la grâce incréée de Dieu.
Tout cela n’est qu'un œcuménisme de surface,
dont le défunt Père Dumitru Staniloae a justement écrit: «De temps en temps, du
grand désir d'unité, émerge un enthousiasme facile, qui croit que la réalité
peut être avec une relative facilité transformée et remodelée par la force des sentiments. Une mentalité diplomatique et conciliante émerge également, qui
estime que les positions doctrinales ou d'autres problèmes plus généraux qui séparent
les églises peuvent être résolus par des concessions mutuelles. Ces deux
façons de traiter avec - ou d'ignorer - la réalité affiche une certaine
élasticité, ou tendance à relativiser la valeur qu'ils attribuent à certains
articles de foi des Églises. Cette tendance à relativiser reflète sans doute la très faible importance que certains groupes chrétiens – soit en partie ou en totalité – attachent à ces articles de foi. À partir de l’enthousiasme
ou de leur mentalité diplomatique, ils proposent des arrangements ou des
compromis sur ces articles de foi précisément parce qu'ils n’ont rien à perdre
avec ce qu'ils proposent. Ces compromis, cependant, représentent un grand
danger pour les Églises dans lesquelles les articles pertinents sont d'une
importance capitale. Pour ces églises, des propositions concernant des arrangements
et des compromis de cette nature équivalent à des attaques non dissimulées.
Dans le même temps, les confessions protestantes, qui sont
allées jusqu'à nier certaines doctrines fondamentales de la foi (l'historicité
de la Résurrection, la virginité perpétuelle de la Mère de Dieu, etc.) et à
accepter des pratiques qui vont à l'encontre de l'esprit de l'Évangile (mariage
entre homosexuels), se voient accorder un statut égal sur les panneaux du
Conseil œcuménique des Églises avec les plus saintes Églises orthodoxes
locales. La théorie de la «démythologisation», «théologie» ou «mort» de Dieu,
l'ordination des femmes prêtres, et la célébration de mariages homosexuels par
des prêtres ne font certainement pas partie de notre identité chrétienne.
Le Protestantisme connaît une profonde
crise de la foi. Dans son livre Danser seul : La quête de la foi orthodoxe à
l'ère de la fausse religion (Regina Orthodox Press, Salisburg, USA), Frank
Schaeffer, le protestant américain bien connu qui est devenu orthodoxe après
une quête personnelle longue et ardue, fournit beaucoup d'informations
intéressantes montrant à quel point le protestantisme est désormais tombé loin
de la vérité de l’Église Une, Sainte, catholique et Apostolique.
Syncrétisme interreligieux
Une extension logique et la conséquence
inévitable du syncrétisme inter-chrétien est le syncrétisme inter-religieux,
qui reconnaît la possibilité de salut pour quiconque appartient à l'une des
religions monothéistes. Un évêque orthodoxe a écrit que : "au fond, à la fois les
églises et les temples (mosquées) visent à permettre à l'homme d'atteindre le
même développement spirituel".3 Le syncrétisme inter-religieux n’hésite même pas
à reconnaître des chemins vers le salut dans toutes les religions du monde. 4
Il y a quelques années, un professeur à
l'Université d'Athènes a écrit qu'il pouvait allumer une bougie devant une
icône de la Vierge Marie tout aussi bien qu'il pourrait en allumer une
devant une statue d'une déesse hindoue.
Des évêques Orthodoxes, le clergé et les
théologiens ont, malheureusement, été influencés par la mentalité syncrétiste. Par
leurs points de vue théologiques, que les dirigeants de ce monde et les intellectuels
ont l’habitude d'écouter et reconnaissent comme orthodoxes, ils favorisent
cette mentalité, qui est d'abord une question d'opinion purement personnelle,
de sorte qu’ils en deviennent une «ligne» officielle avec des buts et des
objectifs spécifiques. De ce point de vue, l'amour, sans référence à la vérité
doctrinale, devient le critère principal de l'unité chrétienne, tandis que
l'insistance sur les positions traditionnelles théologiques orthodoxes est
dénoncé comme du sectarisme et du fondamentalisme.
Quant à savoir comment la mentalité
œcuméniste peut construire une identité superficiellement chrétienne pour
l'Europe, les «engagements» pris par les représentants des églises chrétiennes
qui ont signé la Charte œcuménique le 22 Avril 2001 sont caractéristiques.5
La véritable identité
Pourtant, cette identité «chrétienne»
européenne est loin de la véritable identité chrétienne des peuples d'Europe; On
ne peut pas trop fortement souligner que nous faisons une grave injustice à
l'Europe lorsque nous lui attribuons une identité qui n’est pas vraiment, mais
seulement superficiellement chrétienne. Une forme morbide, frelatée, du
christianisme n’est pas le christianisme des catacombes de Rome, de
Saint-Irénée, évêque de Lyon, des moines orthodoxes de l'Écosse et de l'Irlande
ou de la chrétienté dans son ensemble dans le premier millénaire. Une formule frelatée du christianisme ne peut pas protéger les sociétés européennes de
l'invasion des idées et de la morale non-chrétiennes.
C’est déjà un fait bien connu que de
nombreux Européens ont fini par se lasser du rationalisme stérile et sont
nostalgiques d’un mysticisme perdu, et c’est pourquoi ils embrassent l'islam,
le bouddhisme ou l'hindouisme, se tournent vers les religions ésotériques ou
recherchent des expériences métaphysiques dans les mouvements New Age. En
Italie seulement, il y a environ 500 mosquées en activité, tandis qu'en France,
5% de la population est musulmane.
L'Église orthodoxe détient la Vérité. Elle
a le Christ en son centre. Tout y est théanthropique car tout ce qui est offert
au Seigneur, le Théanthropos, est rempli de la grâce incréée de l'Esprit Saint.
C’est pourquoi il peut fournir réconfort et soulagement aux âmes qui cherchent
sincèrement la libération de l'emprise étouffante du rationalisme, du scientisme,
du matérialisme, de l'idéalisme et de la technocratie. C’est pourquoi l'Orthodoxie
ne doit pas être entraînée dans le creuset syncrétiste, et c'est pourquoi l'espoir du
monde entier ne doit pas être perdu!
En tant que pasteurs orthodoxes et croyants
orthodoxes, nous avons le devoir de préserver l'héritage sacré de notre foi
orthodoxe. Saint Paul exhorte les deux anciens d'Ephèse et nos propres
dirigeants de l'Église d’aujourd'hui à «veiller sur vous-mêmes et à tout le troupeau
sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques. Soyez bergers de l'Eglise de
Dieu, qu'il a racheté avec son propre sang »(Actes 20: 28). Et aux fidèles de
Thessalonique et de l'Église dans son ensemble, il a déclaré: «... rester fermes
et maintenez les enseignements que nous vous avons transmis» (II
Thessaloniciens 2: 15).
Un œcuménisme sain
Dans le domaine de la foi, le Vieux
Continent s’est égaré. Le New Age est désormais ouvertement en train de menacer
de dé-christianiser la société européenne. Il n’y a rien d’étonnant à ce sujet. L'Europe a tourné
le dos au Christ, et d’un certain point l’a banni, comme Dostoïevski l’observe
avec justesse dans 'Le Grand Inquisiteur'6, et le saint évêque Nicolas de Ochrid
et Jitsa également notes.7
L'Église orthodoxe doit révéler son don
et sa mission; elle doit annoncer aux peuples de l'Europe que, s’il y a quelque
chose qui peut sauver l'Europe dans cette phase critique de son histoire, c’est
l'Orthodoxie. Ne privons pas notre Église orthodoxe de l'occasion de donner ce
message de salut aux peuples de l'Europe en plaçant la Foi orthodoxe sur le
même plan qu’une hérésie dans la perspective confuse et la vision vague de
l'œcuménisme syncrétiste. Nous pouvons contribuer à une forme saine,
entièrement orthodoxe de l'œcuménisme en révélant le mystère du Dieu-homme (Théanthropos)
et de son Église aux chrétiens d'autres confessions et en proclamant avec le
regretté Ancien St Justin Popovitch, confesseur de la foi :
«Le moyen de sortir de toutes les
impasses – de l'humanisme, de l'œcuménisme
et du papisme – c’est la figure
historique du Dieu-homme, Notre Seigneur Jésus-Christ, et Sa création théanthropique
historique, l'Église, dont il est la tête éternelle, tandis que l'Église est
son Corps éternel. La foi apostolique, catholique et orthodoxe des sept
conciles œcuméniques, les Saints Pères de l'Église et la Sainte Tradition sont
les remèdes qui peuvent redonner une vie nouvelle aux membres de toute hérésie, quel que soit son
nom. En dernière analyse, toutes les hérésies sont créées par l'homme et «à la
manière de l'homme »; chacune d’elles met l’homme à la place du Dieu-homme
ou remplace le Théanthropos par l'homme, et, ce faisant nie et rejette l'Église
... La seule voie de salut de cette situation est la foi apostolique et
théanthropique, c’est-à-dire une retour complet à la voie théanthropique des
Saints Apôtres et des Saints Pères de l'Église. Cela signifie un retour à leur
foi orthodoxe immaculée et au Christ, le Dieu-homme, à leur vie théanthropique
bénie dans l'Église par la puissance du Saint-Esprit, à leur liberté en Christ
... Sinon, sans la voie des saints Apôtres et des Saints Pères de l'Église,
sans suivre la voie tracée par eux pour servir le seul vrai Dieu dans tous les
mondes, sans adorer le seul vrai Dieu immortel, le Christ Théanthropos et
Sauveur, l'homme est voué à se perdre dans la mer morte de l'idolâtrie
européenne civilisée et, à la place du Dieu vivant et vrai, il est voué à adorer
les faux dieux de cet âge, dans lequel il n'y a pas de salut, pas de résurrection
et aucun moyen de déification pour la triste créature appelée homme 8
Archimandrite George Kapsanis,
higoumène du monastère Gregoriou de la Sainte Montagne 2 Novembre 2011
(version française par Maxime le minime de la source)
Références :
Ecclesiologiki Autosyneidesia tonne Orthodoxon apo tis
Aloseos mechri tonne archon tou 20ou Aionos '(La conscience ecclésiologique de
soi des orthodoxes de la chute jusqu'au début du 20ème siècle), dans le volume
collectif EIKOSIPENTAETIRIKON (A Tribute to Metropolitan Dionysios de Neapolis
et Stavroupolis), Thessalonique, 1999, p. 124. Voir aussi Atanasije Jevtic,
évêque de Banat (retraité évêque de Zahumlje-Herzégovine), 'Je Ounia enantion
tis Servikis Orthodoxias »(L'Eglise uniate contre orthodoxie serbe) dans le
volume collectif je OUNIA CHTHES KAI SIMERA (L'Eglise uniate hier et
Aujourd'hui), Armos Pubs., Athènes 1992. sur l'activité de l'Eglise uniate de
Transylvanie voir 30 Vioi Roumanon Agion (La vie des 30 Saints roumains),
Orthodoxos Kypseli, Thessalonique, 1992, p. 123.
Dumitru Staniloae, Gia Enan Orthodoxo Oikoumenismo (Vers un
oecuménisme orthodoxe), Athos Pubs., Le Pirée, 1976, pp. 19-20.
Orthodoxia kai Islam (l'orthodoxie et l'islam), Saint
Monastère de Gregoriou, 1997, p. 16.
Ibid., Pp. 9-11.
Voir la revue Apostolos Varnavas, Nicosie, Chypre, non. 10,
2001, pp. 411-23.
F. Dostoïevski, Les Frères Karamazov.
Archimandrite Justin Popovitch, Orthodoxos Ekklisia kai
Oikoumenismos (L'Eglise orthodoxe et l'œcuménisme), Orthodoxos Kypseli,
Thessalonique 1974, p. 238 et p. 251-52.
Loc. cit.
Inscription à :
Commentaires (Atom)