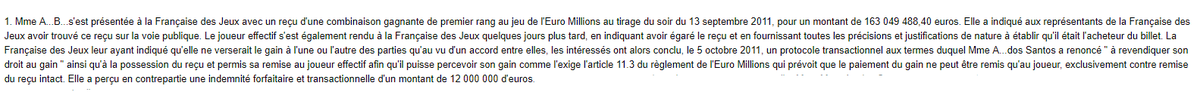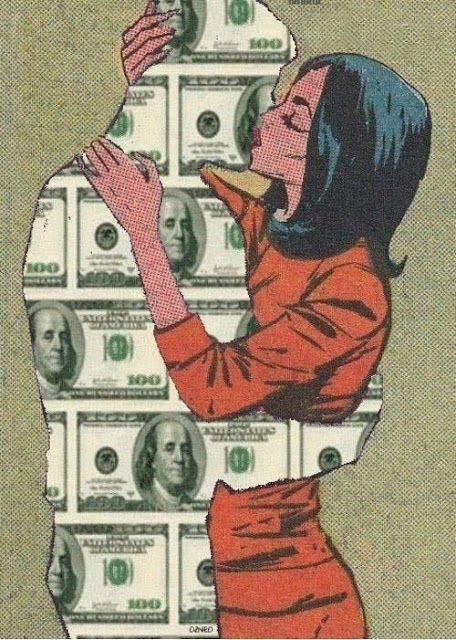P. Jonathan Tobias
On rencontre beaucoup d’anxiété de nos jours à propos de la fin du monde. Et cela ne semble pas préoccuper plus les gens religieux que les non religieux.
De nombreux chrétiens (en dehors de l'Église Orthodoxe) pensent que «la fin» est la période horrible de l'"enlèvement" au Ciel, de la tribulation et de la bataille d'Armageddon. On rapporte des choses étranges sur les laïcs non-religieux qui porteraient sur eux-mêmes la marque lugubre de l'eschatologie «de la fin des temps». Ils sont convaincus par des signes tout aussi inquiétants que la surpopulation, le réchauffement excessif de la Terre, la dépression caldérique de Yellowstone, la collision d’astéroïdes avec la terre, les épidémies virales catastrophiques, voire la prise de contrôle de la civilisation humaine par l’intelligence artificielle.
Je n'exagère pas ici et je ne me moque pas non plus de l'un quelconque de ces groupes trop nombreux. Je pense que nous avons des raisons sérieuses d'être préoccupés par certaines de ces questions.
Mais nous n'avons pas raison d'avoir une telle peur. Et personne n’a le droit d’être l’un de ces marchands de peur qui attisent une telle anxiété, qu’il soit religieux ou scientifique. Les gens peuvent apprendre à être de meilleurs intendants de la planète de sa flore et de sa faune sans pour cela être obnubilés par des spectres menaçants d’effondrement de l’environnement. Trop souvent, un monceau d’anxiété s'accumule par des projections anxiogènes de surpopulation et de changement démographique qui suscitent beaucoup d'anxiété — projections, j'ajouterais, qui sont fondées souvent sur une maîtrise assez médiocre des statistiques. Et ces projections, à leur tour, sont souvent utilisées d’ailleurs à des fins politiques, y compris l'avortement légalisé et les conflits ethniques opportunistes.
En ce qui concerne l'épouvantail de «l'intelligence artificielle», gardons à l'esprit qu'il existe une différence infinie entre le calcul informatisé et la conscience humaine : même un ordinateur super quantique comme le Q System One d’IBM ne s'approchera jamais de la conscience de mon West Highland terrier Wilbur, sans parler de tout être humain. Nous devrions également être attentifs aux origines cachées de tout cela [«follow the money»]: derrière chaque système «d'intelligence artificielle» et de «big data» se trouve un groupe de programmeurs intégralement humains, rémunérés par un groupe caché de personnes qui sont en train de se faire, en dehors des big data, un gros paquet d’argent de façon pas très honnête.
Il y a ces temps-ci une augmentation significative de cas de dépression et d'anxiété aiguë – augmentation qui est due en grande partie à la peur de l'avenir et de la fin du monde (ou du mode de vie américain).
De même, trop de chrétiens (peut-être même certains orthodoxes) ont peur de l'avenir et sont tombés dans une soudaine et irrépressible terreur du Jour dernier (sans parler de la terreur de la rétribution après la mort).
Mais le salut - ou plutôt la theosis - devrait être obtenue par l'amour, non par la terreur… invitée par le Berger, non contrainte par un tyran. J’entends bien qu'une telle assertion est généralement rejetée comme un simple sentiment et qu’elle est associée à des personnes qui ne croient ni en l’Écriture ni dans le credo. Quoiqu’il en soit ce n'est pas mon cas .
Je reconnais également que plusieurs des Pères de la Sainte Tradition ont insisté sur le fait qu'il était nécessaire d'élever ces terrifiants spectres eschatologiques dans des sermons (et dans la rhétorique ecclésiale en général) pour encourager la vertu parmi les fidèles. De nombreux prédicateurs fondamentalistes de la communauté protestante ont la même opinion. C'est une sorte d'«instrumentalisation» de l'eschatologie.
Mais je m'interroge à ce sujet. Il n'est pas évident pour moi que la terreur eschatologique produise de la vertu du tout. Cela produira même plus probablement du désespoir, sinon de l'apostasie et de l'athéisme. Ce n'est pas pour rien qu'Evdokimov a suggéré que l'une des principales causes de l'athéisme européen était l'héritage de l'enseignement calviniste de la double prédestination et d’une théologie volontariste qui avait plus en commun avec l'islam que la théologie trinitaire de la Sainte Tradition.
Il convient donc de garder à l’esprit quelques points, à savoir des considérations encore plus importantes que les craintes «laïques» évoquées plus haut.
D'une part, la théorie de l'"enlèvement" est une invention récente (datant du milieu du XIXe siècle) du segment néo-revivaliste du mouvement protestant. Il va sans dire que cet enseignement sur «l'enlèvement» est au mieux hétérodoxe et au pire hérétique, si ce n’est païen. Nous, les orthodoxes, ne devrions jamais craindre d'être «laissés pour compte», simplement parce qu'il n'y a pas d’ «enlèvement».
Vous avez bien lu. Lorsque Jésus reviendra à la Seconde Venue, ce sera le Dernier Jour, le Grand Jugement, la Résurrection Générale et la Transfiguration universelle de la Création par le Saint-Esprit. Ces événements ne seront pas séparés en événements chronologiques distincts.
C’est ce que nous entendons par l’affirmation de notre foi dans le credo de Nicée: «… et son royaume n’aura pas de fin.» Cette déclaration a été ajoutée lors du Deuxième Concile œcuménique, dans le seul but de surmonter la tendance à imposer une séquence chronologique aux événements de la parousie.
Ainsi, il n'y aura pas de séparation, pas d'intervalles chronologiques distincts, pas de ruptures.
Parousie
D'autre part, Le Livre des Révélations (càd L'Apocalypse de Saint Jean le Théologien) est un genre particulier de littérature biblique que nous appelons «apocalyptique». Cela signifie que très souvent, on ne peut faire de lecture simple et claire du texte. Cela est vrai pour tous les passages bibliques qui parlent de la fin des temps et de l'au-delà, y compris la description de la fin des temps par Jésus dans Matthieu 24.4-36 (et ses parallèles dans Marc 13.3-37 et Luc 21.8-36) et la description de Jésus. de la vie après la mort dans la parabole de l'homme riche et de Lazare (Luc 16.19-31) et sa réponse aux Sadducéens au sujet du mariage au ciel (Matthieu 22.29-30).
Si la Bible (et les Pères) traitent de la fin des temps (et de «la vie après la mort»), il faut alors faire très attention quand on tente de comprendre ces passages. L'Apocalypse de Saint Jean en particulier nécessite une connaissance approfondie non seulement de textes apocalyptiques de Daniel et Ezéchiel dans l'Ancien Testament, mais également de textes similaires dans les Maccabées et Esdras, et même des textes non canoniques de Jubilé et d'Hénoch. Il existe de nombreux passages symboliques difficiles qui doivent être interprétés avec beaucoup de prière, une profonde sagesse et un dur labeur scientifique. Les études bibliques et les écoles du dimanche paroissiales peuvent prendre une tournure désastreuse en s'aventurant dans le mystérieux espace de la Révélation.
Et il y a encore une chose importante. L'Église orthodoxe n'a pas de déclaration doctrinale dogmatique et obligatoire sur la fin des temps, si ce n'est que «… et il reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts, et son royaume n'aura pas de fin». Au vrai, beaucoup d'enseignements patristiques sur la fin des temps vont plus dans les détails - mais ces interprétations spécifiques ne se situent pas au niveau du dogme orthodoxe.
Mais les passages concernant la Fin des temps chez les Pères et dans la Bible décrivent clairement que, de manière certaine, il y a une lutte constante avec l'esprit de l'Antéchrist ici et maintenant. Nous vivons dans l'intervalle entre la Pentecôte et le Jour Dernier. De temps à autre, l’œuvre de ce pouvoir pervers semblera écrasant. Parfois, nous luttons avec l'Antéchrist dans nos propres communautés familiales, et même dans notre propre conscience. De nombreuses fois, des persécutions nous sont infligées de l'extérieur, entraînant des souffrances et un martyre inimaginables. Il n'y a jamais eu d'"enlèvement", car le Corps du Christ est appelé à souffrir avec l'humanité et le monde, et ne pas chercher à échapper lâchement aux douleurs de son enfantement.
Cependant il y a toujours eu la présence spirituelle constante de Jésus-Christ — le don de la Pentecôte.
À travers tout cela, la Sainte Tradition de l'Orthodoxie témoigne et célèbre le pouvoir encore plus grand du Corps du Christ. Le Christ règne à la droite de Dieu le Père, et même maintenant le Père transmet la Royauté – réalisant la gloire du Christ par le Saint-Esprit – à son Fils: "Siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds" (Saint Pierre dans Actes 2.34-35, citant le Psaume 109.1 LXX).
La Nouvelle Jérusalem est même en train de descendre sur terre (Apocalypse 21.2) et le Royaume des Cieux est proche (Matthieu 4.17 et environ quatre autres endroits). C’est notre rôle, en tant qu’Église, de coopérer avec Dieu pour faire descendre sur terre la Belle Ville - une «descente» qui sera accomplie au Jour dernier.
Si une personne est vaincue par la peur et devient désespérée par la Fin des temps – qu'elle soit chrétienne ou laïque – c'est qu'elle ne pense pas au Jour Dernier d'une manière saine et orthodoxe. Le Jour Dernier nous remplit d’espoir : s’il n’y en a pas, alors nous nous sommes trompés de station radio (ou bien nous avons consulté des sites Web moralistes, mais terribles).
«La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.. ”Saint Jean écrivit ceci dans sa première épître (4.18). La communauté chrétienne primitive le savait bien. Quand ils pensaient à la Fin du monde, leur attitude était très différente de la moderniste, caractérisée par la panique et l'effroi.
Ils savaient, sans aucun doute, que le Jour Dernier serait le retour de Jésus-Christ dans le monde dans sa Gloire. Contrairement à sa première venue à Bethléem, cette seconde venue serait évidente pour tout le monde. Le monde entier le reconnaîtrait immédiatement comme le Dieu aimant, clairement beau comme le prince de la paix puissant mais miséricordieux.
A ce moment, l'univers entier sera baigné de la Gloire et de la plénitude de l'amour divin.
Certes, il y aura ceux dont la vie entière est construite sur la violence et la haine, et leur expérience de cette Gloire du Jour Dernier sera épouvantable. Selon la doctrine orthodoxe, cette horrible réaction allergique à l'Amour divin est exactement ce qu'est l'enfer. De toute évidence, le diable est le cas le pire, le plus fou, de ce type de «choc anaphylactique» existentiel.
Mais à ceux qui vivent pour l'Amour, qui respirent en paix, qui donnent leur vie dans la miséricorde et le service, qui attendent la beauté et la bonté, qui cherchent à être divinisés dans le Corps de Christ - alors pour ceux-ci, le Jour dernier où Jésus reviendra sur cette terre sera un jour de joie sans limite.
Ces premiers chrétiens ont regardé le Jour Dernier avec espoir. Ils avaient pour devise: "Marana Tha !", Ce qui signifie (en araméen), "Viens vite, Seigneur!". Ils voulaient voir, dans leur propre vie, le Seigneur qui nous appelle tous ses "amis" (Jean 15.15). Ce ne sont ni des ennemis ni des esclaves du destin, ni des objets de manipulation déterministe, nés seulement pour le chagrin, ils ne sont pas non plus flagellés par la peur.
Mais, mes amis,
La fin du monde concerne en vérité le retour de l’Ami, qui a un Amour infini pour l’humanité. Et c'est quelque chose à espérer et à vivre dans une anticipation sans reprendre son souffle.
version française de la SOURCE
par Maxime le minime